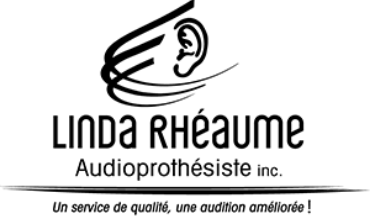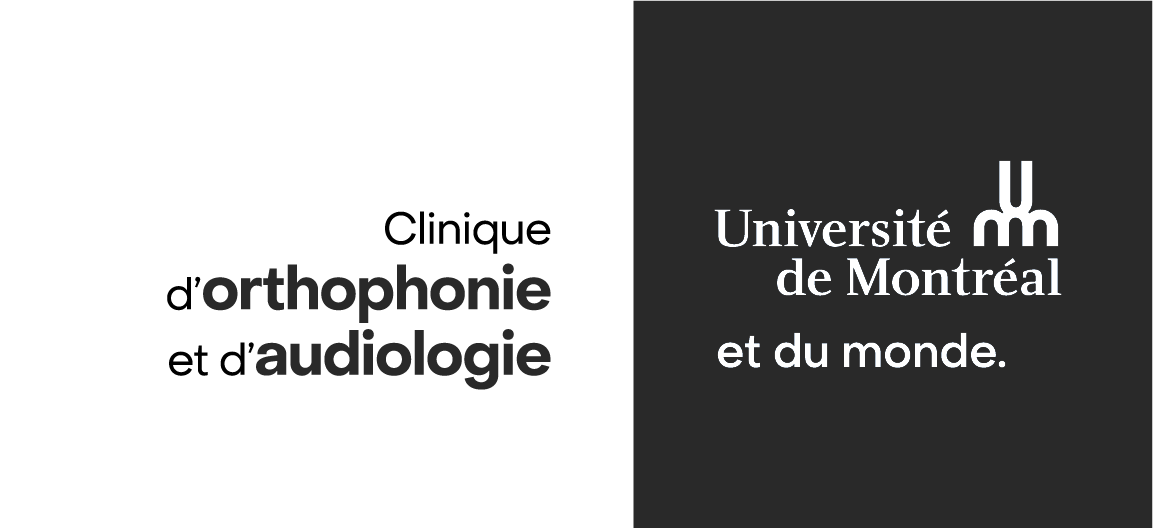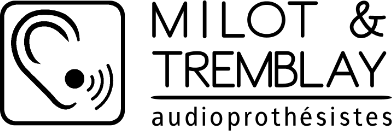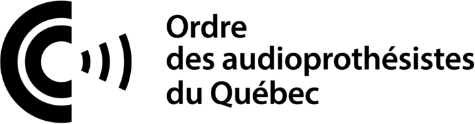Par:
Alexis Pinsonnault-Skvarenina, Ph.D., Professeur adjoint, Université Laval
Mathieu Hotton, Ph.D., Professeur agrégé, Université Laval
Andréanne Sharp, Ph.D., Professeure agrégée, Université Laval
Sebastian Ghinet, Ph.D., Agent de Recherche Senior, Conseil national de recherches du Canada.
Jérémie Voix, ing. Ph.D., Professeur titulaire, École de technologie supérieure

Un besoin criant : mieux entendre à prix abordable
Plus de 3,2 millions de Canadiens vivent avec une perte auditive. Pourtant, près de 84 % d’entre eux n’ont jamais porté d’appareil auditif. Le coût élevé des prothèses conventionnelles, souvent plusieurs milliers de dollars, et la difficulté d’accéder à un professionnel de la santé auditive font que trop de personnes choisissent encore de vivre dans le silence. Les conséquences sont lourdes : isolement, difficultés de communication, fatigue cognitive, repli social et même, parfois, dépression.
Depuis quelques années, une nouvelle génération d’appareils plus simples et plus abordables est apparue : les dispositifs d’écoute alternatifs (DÉA). Ces petits amplificateurs de son, parfois intégrés à des écouteurs sans fil ou à des oreillettes Bluetooth, se vendent librement en ligne ou en pharmacie. Aux États-Unis, ils sont maintenant offerts over-the-counter (en vente libre), souvent pour moins de 500 $.
Mais au Canada, ces produits ne sont ni réglementés ni évalués objectivement. Les consommateurs se fient à des avis laissés sur Internet, souvent biaisés ou incomplets. Résultat : impossible de savoir lesquels de ces appareils sont réellement efficaces, sécuritaires et adaptés à différents besoins d’écoute et de communication.
« Qu’est-ce qu’un DÉA ? »
Un dispositif d’écoute alternatif (DÉA) est un appareil électronique qui se porte à l’oreille et qui comprend une fonction d’amplification du son. Il est vendu directement au consommateur, par exemple, en ligne ou dans un magasin d’électronique, sans prescription médicale. Il peut s’agir :
- d’un produit d’amplification personnel
- d’écouteurs “intelligents” capables de filtrer les bruits et intégrant des fonctions audio avancées;
- d’applications sur téléphone intelligent permettant des fonctions audios avancées comme l’amplification sonore;
- des appareils auditifs en vente libre.
Originalement, plusieurs de ces appareils n’ont pas été conçus spécifiquement pour les personnes qui ont une perte auditive, mais plutôt pour des personnes avec une audition normale souhaitant mieux entendre dans des situations d’écoute difficiles particulières (par exemple, à la chasse, pour écouter la télévision, pour mieux entendre les conversations en milieu bruyant). Ils ne remplacent donc pas une prothèse auditive prescrite par un professionnel de la santé, mais puisqu’ils amplifient les sons un peu comme le font les prothèses auditives et qu’ils sont beaucoup moins chers, ils sont aussi utilisés par des personnes qui ont une perte auditive. En général, les données disponibles suggèrent que les DÉA peuvent convenir à certaines personnes qui présentent des pertes auditives légères à modérées, mais pas aux personnes qui ont des pertes plus sévères.
Un projet de recherche inédit au Canada
Face à cette situation, une équipe conjointe de l’École de technologie supérieure à Montréal et de l’Université Laval à Québec, en partenariat avec le Conseil national de recherches du Canada (CNRC), a lancé le projet :
« Répertoire canadien des dispositifs d’écoute alternatifs abordables. »
L’objectif de ce projet est d’évaluer objectivement les performances des DÉA et de rendre les résultats accessibles au grand public. Le projet s’étend sur trois ans et comporte cinq grandes phases :
- Tests en laboratoire : chaque appareil est évalué selon des normes internationales. On y évalue notamment la puissance maximale, la distorsion, le bruit interne et la fidélité sonore.
- Essais en conditions réelles : une trentaine de volontaires, âgés de plus de 60 ans, testeront les appareils à la maison pendant plusieurs semaines. Une application mobile recueillera leurs impressions au fil des jours.
- Évaluation de la compréhension de la parole et de la localisation des sons : des participants seront placés dans une salle d’écoute immersive. Cette salle, équipée de seize haut-parleurs, permet de simuler des environnements de la vie quotidienne – du salon tranquille au restaurant bruyant.
- Étude de l’effort d’écoute et de la perception musicale : des mesures physiologiques (comme la dilatation de la pupille) serviront à quantifier le “travail mental” exigé pour comprendre la parole avec ou sans appareil.
- Diffusion publique : les résultats seront partagés sous une forme claire et bilingue, à la fois en ligne et dans une édition spéciale de la revue Protégez-vous.

Photo du laboratoire ICAR à l’École de technologie supérieure (ÉTS)
De la recherche à l’action
Le projet ne se limite pas à des mesures techniques. Les chercheurs veulent aussi comprendre l’expérience humaine vécue par les utilisateurs de DÉA : confort, facilité d’utilisation, plaisir d’écouter de la musique ou de converser avec ses proches.
Pour cela, ils travaillent main dans la main avec Audition Québec, un organisme sans but lucratif qui aidera à recruter des participants et à gérer une banque de prêt d’appareils. Les volontaires pourront emprunter un DÉA, le tester, et partager leurs impressions pour aider d’autres personnes à faire un choix éclairé.
« Chaque semaine, je reçois des messages de gens désespérés qui n’ont pas les moyens de s’équiper. Ce projet, c’est une manière de leur redonner de l’espoir. »
— Jérémie Voix, professeur à l’ÉTS

Photo de l’équipe de recherche, de gauche à droite : Jérémie Voix (Professeur, ÉTS), Clémence Lamarche (Chefs des tests, Protégez-Vous), Andréanne Sharp (Professeure, ULaval), Alexis Pinsonnault-Skvarenina (Professeur, ULaval), Mathieu Hotton (Professeur, ULaval), Sébastien Ghinet (Agent de Recherche Senior, CNRC), Jeanne Choquette (Présidente, Audition Québec), Solenn Ollivier (Professionnelle de recherche, ÉTS), Valentin Pintat (Professionnel de recherche, ÉTS), Jean Larivée (Directeur général, Audition Québec)
Une retombée directe pour la population
Au-delà de la science, ce projet pourrait transformer l’accès à la santé auditive au Canada.
Les résultats aideront les gouvernements et organismes de santé à mieux comprendre la valeur réelle des DÉA et, peut-être un jour, à les inclure dans les programmes publics d’accessibilité aux technologies auditives.
Pour les personnes qui vivent avec une perte auditive, c’est une promesse concrète : celle de retrouver une vie sociale active, de renouer avec les conversations familiales, la musique, la joie d’entendre la voix de ses proches – à prix abordable.
Et pour la société, c’est une avancée majeure vers un accès équitable à l’audition : car bien entendre, c’est bien plus qu’un confort – c’est un lien essentiel avec le monde.
Où en savoir plus ?
- Site du projet pilote : Critias
- Partenaire : Audition Québec
- Prochaine étape : diffusion du Répertoire canadien des aides auditives abordables (en ligne et imprimé) prévue en 2027.