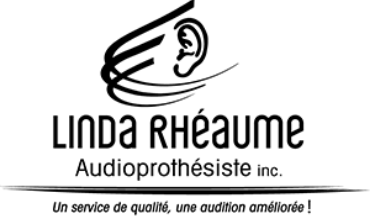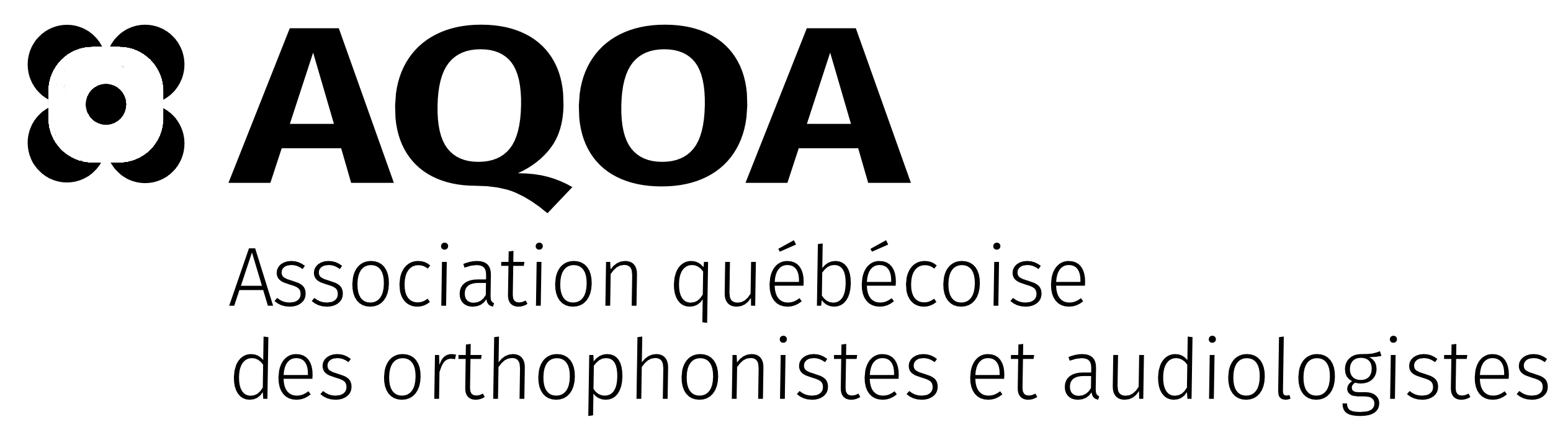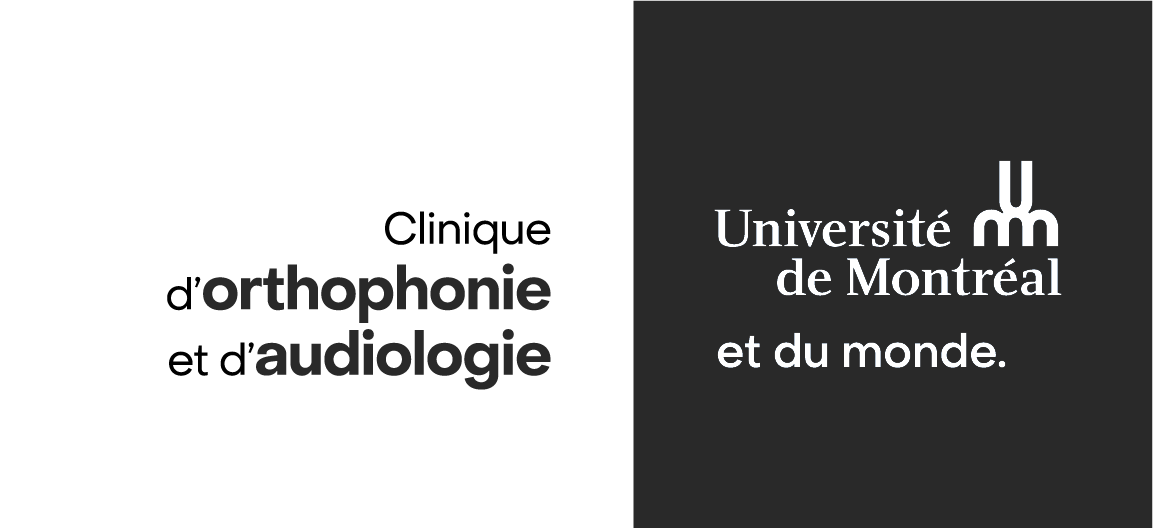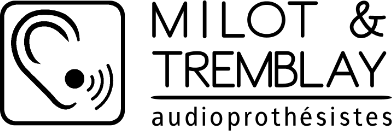Victoria Duda, Ph. D, professeure adjointe à l’École d’orthophonie et d’audiologie de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, chercheure à l’IURDPM – Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal et au CRIR – Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain, mène une étude sur le traitement auditif, ou, en d’autres mots, une étude sur la détection des périodes de silence dans la parole. Jeanne Choquette l’a rencontrée pour en apprendre davantage sur cette recherche et sur les bienfaits que les personnes malentendantes pourront en retirer.
Voici la transcription de cet échange.
Jeanne Choquette : Victoria, tu m’as parlé d’un projet de recherche fascinant qui pourrait avoir des retombées importantes pour les personnes malentendantes. Peux-tu nous en dire un peu plus?
Victoria Duda : Avec plaisir. En fait, notre programme de recherche comporte trois volets, ou phases. Tous sont centrés sur un même thème : le traitement auditif. Pour préciser, le traitement auditif, ce n’est pas simplement entendre. C’est la capacité du cerveau à traiter les sons de manière à en comprendre le sens. On évalue souvent l’audition par les seuils auditifs – le plus petit son qu’une personne peut percevoir – mais cela ne nous dit pas si le cerveau est capable de capter les subtilités des sons qui sont essentielles pour comprendre la parole.
Jeanne : Ah! Ça me parle, parce que souvent, les personnes malentendantes disent : « j’entends, mais je ne comprends pas ». C’est comme si les mots devenaient incomplets.
Victoria : Exactement. Et ce que peu de gens réalisent, c’est que la parole est structurée par des silences, même très brefs. Ces pauses naturelles servent à découper les mots et les phrases. Notre cerveau les utilise pour comprendre le langage. Si ces silences sont mal perçus ou mal traités, la compréhension devient beaucoup plus difficile.
Jeanne : Les silences? Tu veux dire dans les phrases? Peux-tu nous expliquer davantage?
Victoria : Oui. Ce sont de minuscules pauses, souvent de quelques millisecondes, qui se glissent entre les mots ou même entre certaines syllabes. Par exemple, dans la phrase : « Maman donne à Paul une carte du zoo », il y a une pause naturelle entre « Paul » et « une carte ». On ne s’en rend pas compte, mais ces pauses sont indispensables pour que notre cerveau segmente et interprète la phrase. Si on les supprime, ou si on les rend trop brèves, l’intelligibilité chute considérablement.
Jeanne : Donc pour une personne malentendante, c’est comme si ces petites pauses n’étaient plus perceptibles?
Victoria : Oui. Les recherches montrent que les personnes malentendantes ont souvent besoin de pauses plus longues pour bien percevoir les segments de la parole. Si ces pauses sont trop brèves, leur cerveau ne parvient pas à les détecter, ce qui nuit à la compréhension. Et malheureusement, les appareils auditifs actuels ne tiennent pas compte de cette réalité dans leur programmation.
Jeanne : C’est fascinant! Est-ce que ton projet vise à pallier cette lacune?
Victoria : C’est exactement l’objectif. On a développé dans mon laboratoire un test passif pour évaluer cette capacité, qu’on appelle le traitement temporel auditif. L’intérêt de ce test, c’est qu’il ne nécessite pas de réponse verbale ou comportementale : on mesure directement l’activité cérébrale à l’aide d’électrodes pour savoir si le cerveau réagit à ces pauses insérées dans du bruit.
Jeanne : Donc la personne n’a rien à faire? Pas besoin de répondre?
Victoria : Non. Contrairement aux tests cliniques traditionnels, où l’enfant ou l’adulte doit dire s’il entend un ou deux sons, ici, on observe le cerveau en action. Cela nous permet d’évaluer la capacité de traitement sans dépendre de la concentration, du langage ou de la compréhension de consignes complexes.
Jeanne : Et cette capacité est vraiment différente chez les personnes malentendantes?
Victoria : Oui. Selon la littérature, les personnes malentendantes ont des seuils plus élevés pour détecter ces pauses. Autrement dit, il leur faut des silences plus longs pour en percevoir la présence. Et quand ces pauses sont trop brèves, cela affecte leur capacité à discriminer les mots, surtout en contexte bruyant. Pourtant, comme je le disais, les appareils auditifs ne sont pas encore conçus pour compenser ce besoin.
Jeanne : Donc vous testez l’idée que si on modifie les appareils auditifs pour mieux respecter ces silences, la compréhension pourrait s’améliorer?
Victoria : C’est l’hypothèse que nous voulons explorer dans la troisième phase de notre projet. Mais avant cela, nous avons déjà terminé une première phase où nous avons comparé les jeunes adultes et les personnes âgées. Les deux groupes avaient une audition normale, mais nous avons tout de même observé que l’âge influence la capacité de traitement auditif, surtout quand les pauses ressemblent davantage à celles de la parole réelle.
Jeanne : Donc même sans perte auditive, l’âge peut jouer un rôle?
Victoria : Absolument. Et c’est important, car cela montre que la compréhension de la parole ne dépend pas uniquement de l’audition. La seconde phase, qu’on vient de terminer, consistait à reproduire ce test à travers un haut-parleur pour s’approcher davantage des conditions naturelles. Et maintenant, dans la troisième phase, on travaille enfin avec des personnes malentendantes et des appareils auditifs programmés différemment.
Jeanne : Concrètement, qu’est-ce que vous allez tester avec les appareils?
Victoria : On va proposer deux types de programmation : une standard, comme celle utilisée habituellement, et une modifiée, qui introduit des périodes de silence plus longues ou mieux mises en valeur. On veut voir si cette deuxième version permet une meilleure compréhension de la parole, surtout dans le bruit. On espère que ces ajustements pourraient améliorer la discrimination des mots.
Jeanne : C’est vraiment passionnant. Ça pourrait changer la vie de beaucoup de gens!
Victoria : On l’espère. L’objectif à long terme serait d’intégrer ces paramètres dans la conception des futurs appareils auditifs, pour les rendre plus adaptés aux besoins réels des personnes malentendantes, en tenant compte de la façon dont leur cerveau traite les sons, et pas seulement de leur seuil auditif.
Jeanne : Merci beaucoup, Victoria, pour ces explications si claires. Et surtout, merci pour cette recherche qui s’annonce prometteuse pour notre communauté!
Victoria : Merci à toi pour ton intérêt. C’est toujours un plaisir de partager nos travaux, surtout quand ils peuvent vraiment faire une différence.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Vous désirez participer à cette recherche? Voici les détails et modalités de participation.
Laboratoire de la cognition, de l’audition et de la temporalité
Cette recherche est financée notamment par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada.