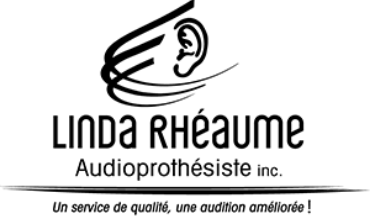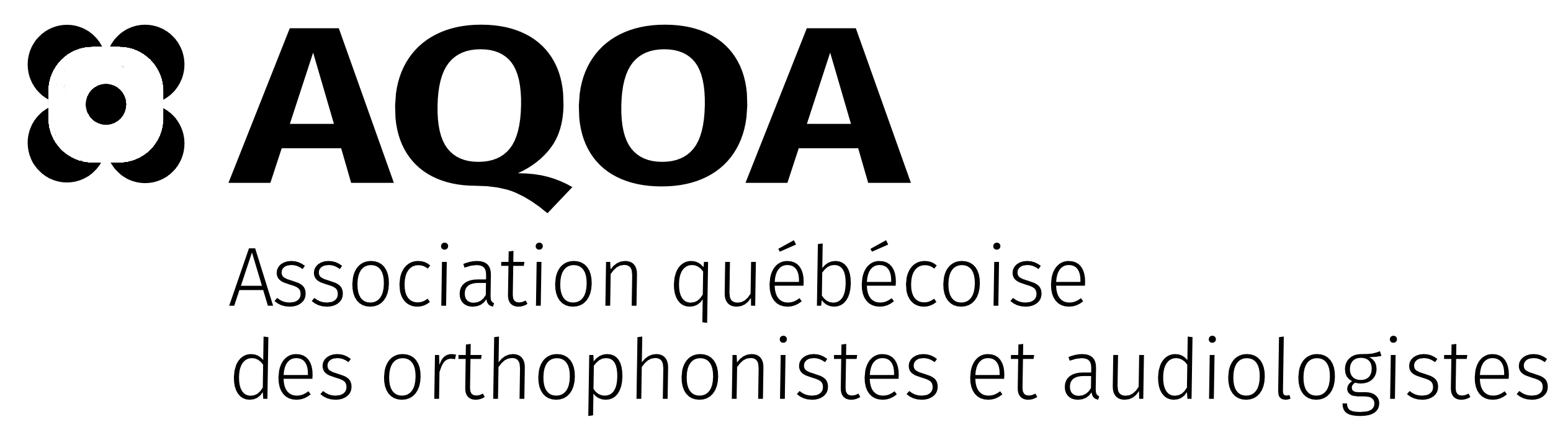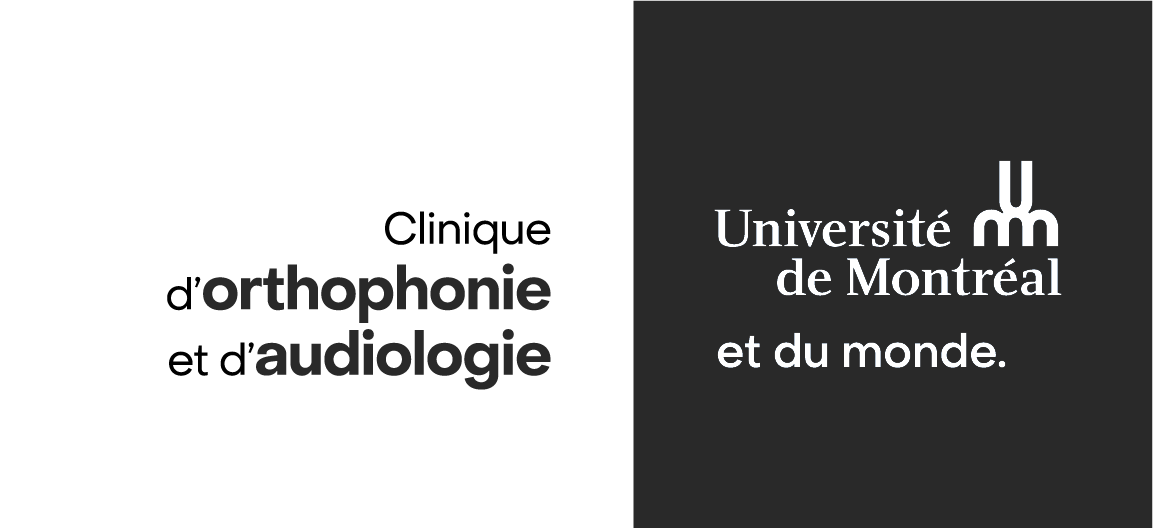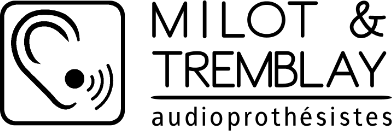Andréanne Sharp, professeure à la Faculté de médecine de l’Université Laval, audiologiste et chercheuse spécialisée en neurosciences auditives, perception musicale et réadaptation, est lauréate du concours Chercheur-Boursier Junior 1. Ce programme vise à faciliter le recrutement de chercheurs et de chercheuses qualifiés qui désirent entreprendre ou poursuivre une carrière autonome en recherche dans le domaine de la santé humaine.
Je lui ai posé quelques questions afin d’en savoir plus sur ses recherches ainsi que sur son parcours et ses motivations à faire avancer la science en audiologie.
🎓 Sur la reconnaissance reçue
Qu’avez-vous ressenti en apprenant que vous étiez lauréate du concours Chercheur-Boursier Junior 1?
Qu’est-ce que cela représente pour vous personnellement et professionnellement?
C’est une grande fierté! Cette bourse de carrière représente une importante reconnaissance par les pairs considérant que l’évaluation pour ce concours repose principalement sur l’excellence du dossier de recherche ainsi que la qualité et le potentiel du programme de recherche proposé. Ce financement soutient le chercheur ou la chercheuse de deux façons. D’abord, les Fonds de recherche du Québec – Santé offrent une bourse permettant de couvrir une grande partie du salaire du chercheur ou de la chercheuse, ce qui permet à l’Université de recruter des ressources supplémentaires et de réduire la charge administrative et d’enseignement du professeur.e. La personne sélectionnée peut ainsi consacrer au minimum 75 % de son temps à la recherche pendant quatre ans. Ensuite, dans le cadre de la bourse Junior 1, destinée aux chercheurs et chercheuses en début de carrière, un soutien financier est également accordé pour les activités du laboratoire. Cela représente un appui considérable, car il me permettra non seulement de consacrer davantage de temps au développement de mon laboratoire, mais aussi de supporter une personne étudiante qui souhaite poursuivre aux cycles supérieurs en recherche.
En tant qu’audiologiste et chercheuse, dont le programme de recherche vise à trouver des solutions pour répondre à des enjeux de santé auditive, je vois cette reconnaissance comme un pas dans la bonne direction. Elle contribue à faire valoir l’importance de la santé auditive comme enjeu de santé publique. Il est essentiel que cette problématique soit reconnue comme prioritaire, notamment dans le contexte du vieillissement de la population, en raison des nombreux effets collatéraux que les troubles auditifs peuvent avoir sur la santé.
🧠 Sur le programme de recherche
Pouvez-vous nous expliquer, en mots simples, votre programme de recherche?
Comment vous est venue l’idée d’utiliser un sens alternatif — les mains — pour transmettre les sons?
Au sein de mon laboratoire, mon équipe et moi étudions comment le cerveau fait le traitement et l’analyse des signaux sonores complexes, comme la musique ou la parole dans un environnement bruyant où plusieurs sources sonores sont en compétition. Nous cherchons également à comprendre comment la perte auditive rend plus difficile la perception dans ces contextes exigeants. Notre objectif est de mieux comprendre ces mécanismes afin de développer de nouvelles solutions pour améliorer l’écoute de la musique et la compréhension de la parole en milieu bruyant chez les personnes malentendantes. Parmi les pistes explorées, nous travaillons sur une nouvelle technologie, les gants vibrotactiles, qui permettent de transmettre les sons via les mains, et ainsi, permettent l’ajout d’indices tactiles lors de la perception auditive. Nous explorons aussi l’utilisation de la musique comme outil de réadaptation des habiletés auditives centrales. Enfin, nous nous intéressons aussi à l’émergence de nouvelles technologies en santé auditive, comme l’intégration de l’intelligence artificielle dans les appareils auditifs.
La musique, l’une des plus anciennes formes d’art, demeure aujourd’hui une source majeure de plaisir dans la vie des humains. Son appréciation repose sur l’analyse fine de séquences sonores complexes, ce qui devient difficile en cas de perte auditive. C’est ce constat qui m’a amenée à me demander : pourquoi ne pas faire appel à un autre sens, comme le toucher, pour compenser ces difficultés? Avez-vous déjà posé vos mains sur des haut-parleurs? On peut alors ressentir les sons : le rythme, les fréquences, les émotions. C’est une pratique courante dans la communauté sourde, où l’on place parfois les haut-parleurs au sol et à fort volume pour ressentir la musique dans tout le corps. Pourtant, très peu de technologies exploitent aujourd’hui ces indices tactiles.
Leur développement est freiné par le manque de recherche sur la manière dont ces signaux peuvent améliorer la perception auditive et sur la capacité du cerveau à les intégrer. C’est pourquoi nous poursuivons nos travaux sur la perception vibrotactile, avec l’ambition de créer des outils qui répondent aux besoins des personnes malentendantes, tout en offrant des expériences immersives accessibles à tous. Ces technologies pourraient aussi aider les musiciens à mieux se synchroniser lorsqu’ils jouent ensemble dans des environnements bruyants.
💬 Sur l’impact humain
Quels effets secondaires de la surdité non compensée vous ont particulièrement marquée ou motivée dans vos recherches?
Avez-vous une anecdote touchante ou marquante d’un moment dans votre recherche ou avec un participant?
J’ai grandi dans une famille de musiciens. J’ai commencé la musique très jeune, et elle occupe encore aujourd’hui une place importante dans ma vie. C’est d’ailleurs la musique qui m’a naturellement guidée vers l’audiologie, un domaine où je peux conjuguer mes deux passions.
Durant mes études cliniques, une audiologiste m’a raconté l’histoire d’un musicien professionnel ayant perdu l’audition de façon soudaine. Sa vie avait été bouleversée, et malgré les technologies disponibles, rien ne lui donnait le goût de rejouer de son instrument. Cette histoire m’a profondément marquée. C’est à ce moment-là que j’ai su que je voulais travailler à trouver des solutions pour aider non seulement les musiciens, mais aussi toutes les personnes qui aiment la musique, et elles sont nombreuses. Dans ma pratique clinique, j’ai souvent entendu des patients me dire que, même avec leurs appareils auditifs, la musique ne sonnait plus comme avant. Une autre plainte fréquente des patients concerne la difficulté à comprendre la parole dans le bruit, un enjeu majeur, car la plupart des interactions sociales se déroulent dans des environnements sonores imparfaits. Le point commun entre la musique et la parole dans le bruit, c’est ce qu’on appelle l’analyse de la scène auditive : la capacité du cerveau à organiser les sons, à fusionner certains éléments (comme entendre une chorale chanter à l’unisson comme une seule voix) ou à les séparer (comme distinguer les différents instruments dans un trio de jazz). C’est ce qui m’a amenée à m’intéresser à l’audition centrale, et à chercher des solutions pour compenser les difficultés liées aux changements du cerveau auditif en lien avec la surdité.
🌱 Sur son parcours et sa motivation
Qu’est-ce qui vous a motivée à vous lancer dans la recherche en réadaptation auditive?
Quels défis avez-vous rencontrés comme jeune chercheuse?
Quand j’ai fait le choix lors de mon parcours, il y a maintenant plus d’une dizaine d’années, de mettre tout en place afin de tenter d’atteindre un jour une carrière académique et ainsi, pouvoir consacrer une grande partie de mon temps à la recherche, le chercheur-boursier était à ce moment un rêve bien lointain, mais c’était là depuis le tout début. Mon but en prenant cette décision de parcours était de développer les connaissances dans le domaine de l’audition, car je trouvais qu’il y avait encore trop de questions non répondues, des questions essentielles pour mieux aider les personnes malentendantes, mieux outiller les clinicien.ne.s à faire leur travail, améliorer les pratiques dans le domaine, augmenter les options d’outils technologiques, mieux former les futurs professionnels, etc.
En tant que jeune chercheuse, j’ai été confrontée à plusieurs défis. L’un des plus grands a été de démarrer mon laboratoire à partir de zéro, un peu comme on lancerait une entreprise. Il a fallu tout construire : définir une vision de recherche, obtenir du financement, recruter une équipe, mettre en place des protocoles, et créer un environnement de travail propice à la formation. Un autre défi majeur est lié à la compétitivité du milieu de la recherche. Il faut constamment se démarquer, publier, obtenir des subventions, tout en maintenant une rigueur scientifique élevée.
Et faire sa place est encore plus complexe dans un domaine comme la santé auditive et la réadaptation, qui historiquement manque souvent de reconnaissance, malgré son impact profond sur la qualité de vie, en particulier dans le contexte du vieillissement de la population. Il faut donc redoubler d’efforts pour faire valoir l’importance de ces enjeux, tant auprès des instances de financement qu’au sein de la communauté scientifique. La pandémie a aussi représenté un obstacle important. Elle a ralenti plusieurs projets, complexifié la collecte de données. Mais elle m’a aussi permis de développer ma capacité d’adaptation ainsi que ma créativité. Ces défis m’ont permis de mieux comprendre mes forces, de rester fidèle à ma vision, et de m’engager pleinement dans une recherche porteuse de sens pour moi.
🌟 Pour terminer
Si vous pouviez imaginer l’impact de votre travail dans 10 ans, que verriez-vous?
Mon ambition est de développer une version des gants vibrotactiles transportables, adaptés à un usage quotidien. Ce serait un véritable accomplissement que d’assister à un concert de l’orchestre symphonique et de voir des spectateurs porter ces gants pour vivre une expérience multisensorielle. Cela dit, la recherche est un processus lent qui exige de la patience : dix ans, dans ce domaine, c’est relativement court. Je serais ravie de vous reparler dans dix ans pour vous présenter les avancées réalisées.
Andréanne Sharp, PhD, M.P.A., est professeure à la Faculté de médecine de l’Université Laval, audiologiste et chercheuse spécialisée en neurosciences auditives, perception musicale et réadaptation. Son parcours musical l’a inspirée à développer des projets de recherche mettant en lien audiologie et musique. Dans sa pratique clinique en audiologie à travers le Québec, elle a rencontré de nombreux patients se plaignant de difficultés à percevoir la musique avec leurs aides auditives. Elle a donc vu la nécessité de développer de nouveaux outils de réadaptation pour pallier ces difficultés. En 2020, elle a fondé le Laboratoire de perception multisensorielle et auditive (MAPLab) au Centre de recherche CERVO, spécialisé dans l’étude de la perception auditive, tactile et multisensorielle via des techniques comportementales, électrophysiologiques et de neuroimagerie. Dans son laboratoire, la professeure Sharp s’intéresse à l’émergence des nouvelles technologies en santé auditive, poursuit le développement de technologies vibrotactiles, et explore l’utilisation de la musique comme outil de réadaptation des habiletés auditives.