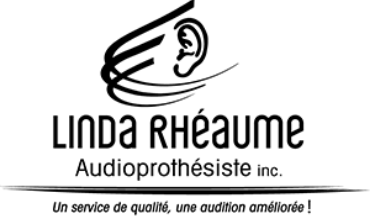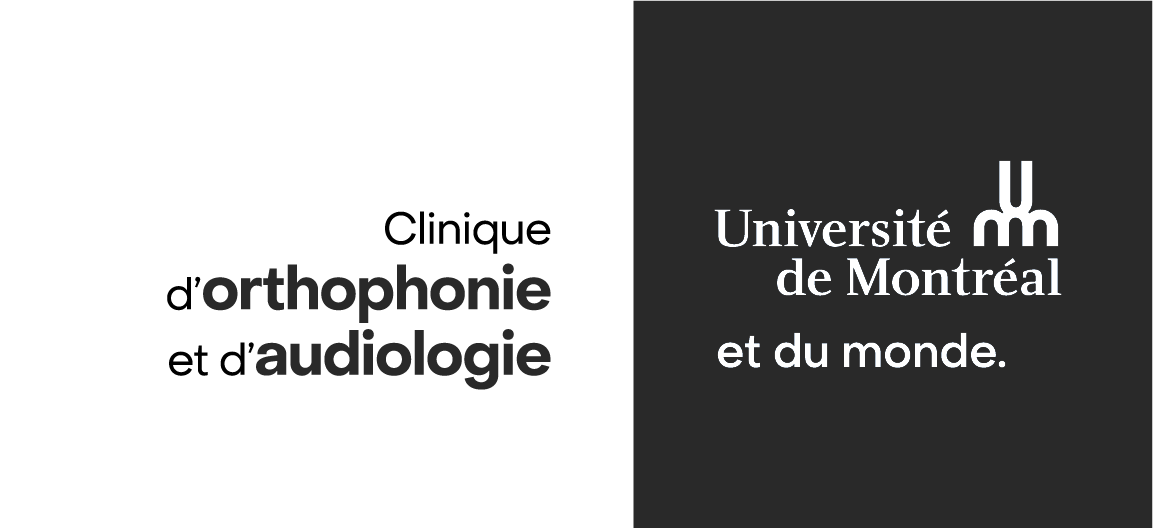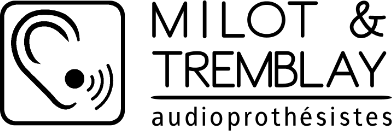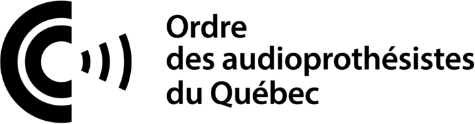Par Maude Gagnon, Alexandra Tessier, Sandie Poulin et Marie-Christine Hallé, membres de l’équipe de recherche Pratiques sociales et surdité
Le colloque La communication accessible : une responsabilité partagée s’est tenu les 8 et 9 mai derniers à l’École de technologie supérieure (ÉTS) à Montréal, dans le cadre du 92e Congrès de l’Acfas (Association canadienne-française pour l’avancement des sciences). Des personnes issues du milieu de la recherche, des milieux communautaires et associatifs, de la clinique, ainsi que des personnes directement concernées se sont rassemblées pour réfléchir aux moyens de réaliser l’accessibilité communicationnelle.
Cet événement a été organisé par des membres de l’équipe de recherche Pratiques sociales et surdité (Alexandra Tessier, Maude Gagnon, Sandie Poulin, Marie-Christine Hallé, Victoria Duda et Audrey Dupont).
La genèse du projet
Il y a un an, une idée a émergé lors d’une rencontre du comité organisateur : celle de tenir un colloque sur le thème de l’accessibilité communicationnelle. Pourquoi? Parce que nous avons réalisé que des personnes aux profils variés, par exemple vivant avec l’aphasie ou ayant une surdité, font face à des enjeux similaires sur le plan de la communication.
Au Canada, on estime qu’une personne sur six vit des situations de handicap en lien avec la communication. Ces personnes peuvent avoir du mal à comprendre les messages transmis par les autres ou à s’exprimer dans certains contextes. Ces difficultés peuvent être plus importantes, notamment dans un environnement bruyant et face aux attitudes ou aux comportements inadaptés de la part des gens avec qui elles échangent. Elles peuvent aussi se manifester lorsque des mesures d’adaptation comme le sous-titrage en direct sont manquantes.
Un accès entravé, fastidieux et partiel à la communication peut avoir des répercussions importantes sur différentes sphères de la vie d’une personne, telles que ses relations sociales, ses apprentissages, sa santé mentale et sa participation dans différentes activités du quotidien. Pourtant, à ce jour, on parle encore très peu de rendre la communication plus accessible dans les lieux publics. Tout comme une rampe d’accès permet à plus de personnes d’entrer et sortir de façon autonome d’un bâtiment, certaines mesures peuvent faciliter la communication. Selon l’analogie d’Aura Kagan, on peut concevoir ces mesures à la manière d’une « rampe communicationnelle ». À titre d’exemples, offrir l’interprétation en langue des signes, utiliser un langage simple et des icônes dans l’affichage public ou faire sentir à la personne qu’elle peut prendre tout son temps pour exprimer son idée sont autant de mesures qui jouent le rôle de « rampe communicationnelle ».
Le colloque : un franc succès!
Au moment de lancer l’appel de communications, nous ignorions si le sujet allait susciter l’intérêt. La réponse a été enthousiaste : plus de 20 propositions de présentations ont été soumises par des personnes expertes de différents rôles et horizons! Ces personnes s’intéressaient à des sujets variés comme la surdité, la neurodiversité, l’aphasie, le vieillissement ou le trouble développemental du langage. Au premier jour du colloque, nous avons même fait salle comble. Au total, nous estimons que le colloque La communication accessible : une responsabilité partagée a rejoint environ 80 personnes sur les deux jours. Les échanges ont été d’une grande richesse, si bien que les périodes de questions dépassaient souvent les 10 minutes prévues.
Vous pouvez consulter un bref résumé de chacune des présentations orales sur le site web du 92e Congrès de l’Acfas : Résumés des présentations.

Des échanges aux actions
La dernière journée du colloque s’est terminée par un exercice de priorisation concernant les mesures d’accessibilité communicationnelle. Des personnes chercheuses, des intervenantes, des personnes concernées par des enjeux de communication, ainsi que des membres de milieux communautaires et associatifs ont dressé ensemble une liste de 25 mesures, puis ont voté individuellement pour déterminer les cinq priorités à mettre en place afin de favoriser la communication dans divers contextes. La mesure arrivée en tête : la création d’un regroupement pour rassembler les personnes concernées par l’accès à la communication et agir collectivement en faveur de cette cause.
Et pour la suite? Une publication scientifique à propos de l’exercice de priorisation ainsi qu’un résumé en français sont en cours de rédaction. La réalisation de ces publications permettra de partager plus largement les résultats de cet exercice au cours des prochains mois.
Pour connaître les suites du projet et les activités de l’équipe de recherche Pratiques sociales et surdité, nous vous invitons à suivre notre page Facebook : Facebook
et notre page LinkedIn : Linkedln
Remerciements
Enfin, nous souhaitons remercier l’équipe Pratiques sociales et surdité ainsi que la Fondation Lucie et André Chagnon pour leur soutien financier.
Références
Agaronnik, N., Campbell, E. G., Ressalam, J., & Iezzoni, L. I. (2019). Communicating with patients with disability: Perspectives of practicing physicians. Journal of General Internal Medicine, 34, 1139–1145.
Collier, B., Blackstone, S. W., & Taylor, A. (2012). Communication access to businesses and organizations for people with complex communication needs. Augmentative and Alternative Communication, 28(4), 205–218. https://doi.org/10.3109/07434618.2012.732611
Johansson, M. B., Carlsson, M., & Sonnander, K. (2012). Communication difficulties and the use of communication strategies: From the perspective of individuals with aphasia. International Journal of Language & Communication Disorders, 47(2), 144–155. https://doi.org/10.1111/j.1460-6984.2011.00089.x
Kagan, A. (1998). Supported conversation for adults with aphasia: Methods and resources for training conversation partners. Aphasiology, 12(9), 816–830.
Law, J., van der Gaag, A., Hardcastle, W. J., Beckett, D. J., MacGregor, A., & Plunkett, C. (2007). Communication support needs: A review of the literature. Scottish Executive.
Orthophonie et Audiologie Canada. (2015). La santé de la communication et le vieillissement. https://www.sacoac.ca/wp-content/uploads/2023/01/communication_health_and_aging_brochure_web_fr.pdf
St-Louis, A. (2021). Accessibilité universelle : La conception d’environnements pour tous (OPUS no 6). Institut national de santé publique du Québec. https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2775-accessibilite%20universelle-conception-environnements.pdf